Sylvie Kauffmann – Le Monde 20 juin 2012
C’est l’une des ironies du « printemps arabe », et ce n’est pas la moindre : au Caire, la place Tahrir, haut lieu de l’esprit révolutionnaire qui souffla sur la région les premiers mois de 2011, est une zone à haut risque pour les femmes. Elles y étaient pourtant venues nombreuses, à l’époque, et leur rôle actif dans les manifestations qui ont abouti au renversement du régime Moubarak a été généreusement célébré.
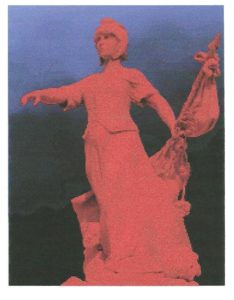 Mais très vite, le climat s’est dégradé, et les femmes qui participaient aux manifestations ont été la cible d’agressions sexuelles. On est, là, bien au-delà du harcèlement, comportement dont les Egyptiens sont malheureusement assez coutumiers en dehors des phases révolutionnaires, dans la rue et les transports publics. De multiples témoignages, plaintes, photos et vidéos ont confirmé un recours systématique à l’arme de l’agression sexuelle contre les femmes en Egypte lorsqu’elles se joignent à des mouvements massifs de contestation de rue.
Mais très vite, le climat s’est dégradé, et les femmes qui participaient aux manifestations ont été la cible d’agressions sexuelles. On est, là, bien au-delà du harcèlement, comportement dont les Egyptiens sont malheureusement assez coutumiers en dehors des phases révolutionnaires, dans la rue et les transports publics. De multiples témoignages, plaintes, photos et vidéos ont confirmé un recours systématique à l’arme de l’agression sexuelle contre les femmes en Egypte lorsqu’elles se joignent à des mouvements massifs de contestation de rue.
L’agression peut revêtir diverses formes. Il y a la forme extrême, le viol à plusieurs, sous les regards, voire la protection de la foule. Il y a l’agression à caractère sexuel doublée de coups et blessures, parfois perpétrée par les forces de l’ordre elles-mêmes, comme l’ont montré les images-chocs de décembre et la photo si hautement symbolique de soldats se déchaînant à coups de pied sur le corps d’une femme dont on ne voyait plus que le soutien-gorge bleu sous le niqab arraché. Et puis il y a, simplement, serait-on tenté de dire, les attouchements, le vulgaire pelotage, qui s’arrêtent là lorsqu’on arrive à prendre la fuite. La place Tahrir reste le seul lieu des soulèvements arabes où des journalistes étrangères ont été violées en faisant leur travail et où Reporters sans frontières a fini par leur déconseiller de se rendre – une grande première dans la profession.
Le fléau a repris il y a deux semaines lorsque les manifestants sont de nouveau descendus sur la place Tahrir pour protester contre le déroulement de l’élection présidentielle. Aussitôt, des alertes à l’agression sexuelle, suivies d’appels à l’aide, ont été lancées sur Twitter : « Ça recommence ! » Une marche de protestation a été organisée le 8 juin, place Tahrir. Seule une cinquantaine de femmes y ont participé, alors qu’elles avaient été plus de dix mille cet hiver. Des hommes ont accepté de les protéger en créant un cordon de sécurité autour d’elles. Eux-mêmes ont été attaqués et débordés ; les femmes n’ont eu que le temps de se réfugier dans un bâtiment voisin. Une reporter d’Associated Press qui couvrait l’événement a elle-même été agressée. Dans son article, elle décrit la scène terrifiante d’une jeune femme coincée contre un mur, assaillie par quelque 200 hommes, et qui finit par s’évanouir avant que de bons samaritains parviennent enfin à la secourir, au milieu des coups.
Evoquez ces incidents avec des Egyptiennes et vous aurez une palette de réactions variées, allant de l’indignation naturelle au déni. Beaucoup attribuent ces agressions à une tactique délibérée de l’appareil de sécurité, qui « paie des voyous » pour agresser les femmes, afin de les dissuader, elles, mais aussi leurs maris, leurs frères et leurs pères, de venir manifester. De fait, ces derniers soirs, la foule de la place Tahrir était essentiellement masculine. « Ils » ont gagné.
Que nous dit la triste histoire de la place Tahrir, cette histoire dans l’histoire de la cruelle désillusion égyptienne ? Que l’évolution du sort des femmes dans le monde arabo-musulman est aussi fragile que celle des aspirations démocratiques. L’attribution du prix Nobel de la paix 2012 à des femmes, dont une icône du « printemps arabe », la Yéménite Tawakul Karman, devait les encourager. Hillary Clinton, chef de la diplomatie américaine et infatigable avocate de l’émancipation féminine, n’a pas marchandé son soutien. Mais cette évolution ne dépend pas des appuis extérieurs – du moins pas de ceux-là.
Egyptienne et américaine, Mona Eltahawy est des deux côtés du miroir. Arrêtée, rouée de coups et agressée sexuellement par des policiers il y a six mois place Tahrir, elle a écrit, comme pour évacuer sa rage, un brillant et violent réquisitoire contre la misogynie des sociétés arabes dont le magazine américain Foreign Policy a fait sa couverture en mai, sous le titre : « Why Do They Hate Us ? » (« Pourquoi nous détestent-ils ?). L’article, dénonçant pêle-mêle la violence sexuelle, l’interdiction de conduire pour les Saoudiennes, l’excision et le mariage forcé d’adolescentes, a fait le tour d’Internet. La virulence des réactions du public arabe, y compris féminin, a surpris Mona Eltahawy, accusée de donner une image dégradante de la société arabo-musulmane.
Car une chose est de formuler des critiques objectives, comme la sous-représentation des femmes dans la politique, une autre est de s’attaquer aux fondements culturels et religieux des sociétés arabes. Le Parlement égyptien élu cet hiver – et qui vient d’être dissous – ne comptait que 2,4 % de femmes, contre 12 % sous Moubarak ? Tout le monde est d’accord, c’est lamentable. La Tunisie et l’Algérie ont aujourd’hui des Assemblées nationales à forte représentation féminine, grâce à une politique volontariste ? Tout le monde est d’accord, c’est formidable. Le consensus féministe est en revanche bien plus difficile lorsque l’on en vient à l’influence de la culture et de la religion sur les rapports entre hommes et femmes.
Une étude du Gallup Center for Muslim Studies publiée prochainement éclaire utilement ces divergences. Elle conclut que le plus grand défi qui se pose aux femmes après le « printemps arabe » ne vient pas de l’islam, mais de l’insuffisance du développement social et économique et de « ce qu’elles perçoivent comme de l’insécurité » (peut-être l’effet place Tahrir ?). « Les femmes arabes, apprend-on, considèrent qu’elles devraient avoir les mêmes droits que les hommes ». Curieusement, les hommes sont moins nombreux à le penser – c’est même en Tunisie qu’ils sont le plus réticents. C’est un fait : mieux vaut être riche et libre que pauvre et prisonnière. Mais, en attendant d’avoir tout à la fois, l’égalité des droits doit être le minimum, quel que soit l’environnement culturel et religieux.


